" Peut-on encore croire au progrès ? "
Le vendredi 19 septembre 2025 à 17h45
à l'Office de Tourisme La Domicienne Maison du Malpas.
sur le sujet : " Peut-on encore croire au progrès ? "
PRESENTATION
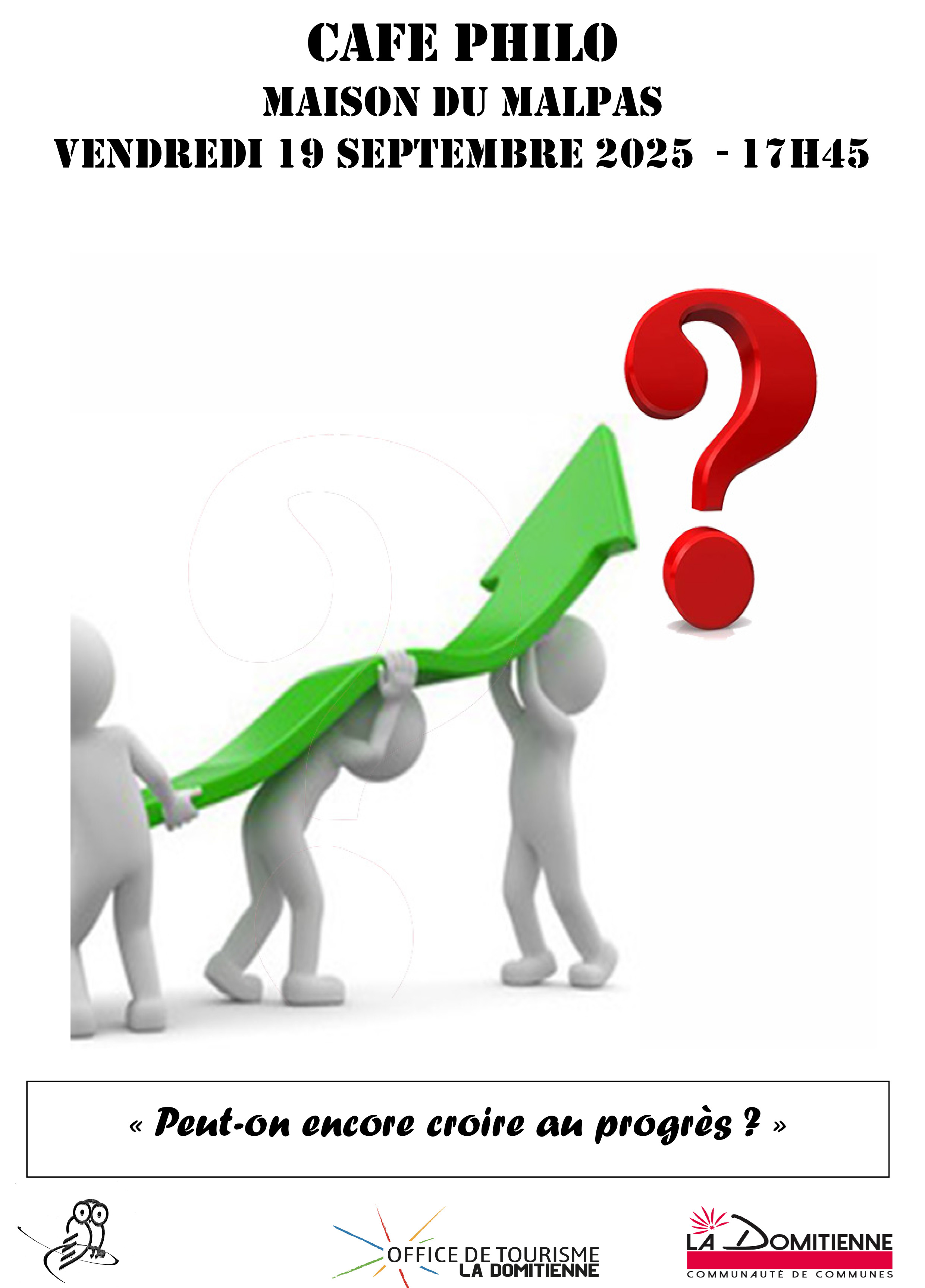
« Cette idée que l’humanité devient de jour en jour meilleure et plus heureuse est particulièrement chère à notre siècle. La foi à la loi du progrès est la vraie foi de notre âge », disait Le Grand Larousse du XIXème siècle. Qu’en est-il maintenant ? La science elle-même, qui était considérée par la pensée des Lumières comme le fer de lance du progrès de l’humanité, est la première à nous mettre en garde sur un avenir pour le moins incertain… Certes, sous son impulsion, le développement technologique et industriel a été constant, et la dernière révolution numérique avec la nouvelle IA promet de bouleverser nos modes de vies. Mais dans ces périodes de crises à répétition dans tous les domaines, peut-on pour autant affirmer que cela se traduit et se traduira par un progrès global et qualitatif de l’humanité ? Nous avons des raisons aujourd’hui de nous sentir impuissants face à l’avenir qui s’annonce, et peut-être qu’en réalité l’idée de progrès n’est plus de circonstance, qu’elle est condamnée à une obsolescence certaine… Mais l’humanité peut-elle vraiment se passer d’un « temps prometteur », contrairement à ce qu’affirmait Emmanuel Lévinas, pour qui cette perspective nous était indispensable, à nous les occidentaux ? Pouvons-nous alors reprendre la main sur notre destin ?
CAFE PHILO SOPHIA MAISON DU MALPAS VENDREDI 19 SEPTEMBRE
« PEUT-ON ENCORE CROIRE AU PROGRES ?
L’idée de progrès a été la grande idée du XIXème siècle, rassemblant les cœurs et les esprits par-delà les divergences entre conservateurs, libéraux ou socialistes. En témoigne par exemple l’article que lui consacre le Grand Larousse de cette époque : « Cette idée que l’humanité devient de jour en jour meilleure et plus heureuse est particulièrement chère à notre siècle. La foi à la loi du progrès est la vraie foi de notre âge. C’est là une croyance qui trouve peu d’incrédules ». Nous ne pouvons pas en dire autant aujourd’hui… Cette croyance, sans doute d’origine religieuse – c’est notamment Saint Augustin qui décrit, sous la conduite de la Providence divine, la croissance spirituelle de l’humanité – devient rapidement séculière (à partir de la Renaissance) et va d’abord concerner l’avènement de la science et des progrès de la connaissance, puis ensuite avec la Modernité et « les Temps nouveaux », devient la croyance au progrès global de l’humanité, au sens où Les Lumières doivent désormais éclairer le chemin d’une émancipation irrésistible dans tous les domaines, un enchaînement causal étant censé relier désormais les sciences, les techniques, l’économie, la vie sociale et le perfectionnement moral. Force est de constater que cette chaine causale ne fonctionne pas, et la science elle-même est la première à nous alerter aujourd’hui sur un avenir inquiétant et incertain… Cependant, il est vrai que l’impulsion du développement scientifique, technologique, industriel a changé nos vies, que la longévité de celles-ci a considérablement augmenté, que la révolution du numérique et la nouvelle IA ont déjà des conséquences considérables sur nos modes de vie, et vont en avoir de beaucoup plus importantes encore… Peut-on continuer cependant à croire à un progrès général de l’humanité ? Emmanuel Lévinas affirmait que les êtres humains ne pouvaient pas se dispenser de penser un avenir prometteur… Si tel est le cas, à quelles conditions raisonnables pouvons-nous continuer à croire au progrès aujourd’hui ? Et pour commencer, comment définir le plus fidèlement possible cette croyance au progrès qui a profondément marqué nos vies pendant au moins deux siècles ?
L’IDEE DE PROGRES
C’est-à-dire ?
Dans son sens le plus rigoureux, nous la définirions comme une succession d’états de choses allant dans la même direction, telle que t1 < t2 < t3 … t3 ajoute quelque chose à t2 tout en le conservant, développant simplement ce qui est en germe en t2.Ainsi le progrès est cumulatif. S’ajoute à cette définition une dimension axiologique selon laquelle cette transformation graduelle va du moins bien au mieux[1].
Perfectibilité
Cette notion est centrale dans la pensée de Rousseau : historicité et perfectibilité deviennent des caractéristiques de l’être humain, aussi bien sur le plan individuel avec l’éducation, que sur le plan collectif à travers l’Histoire. Mais changer n’est pas nécessairement progresser, et la perfectibilité peut faire naître aussi bien « nos vices » que « nos vertus », « nos lumières » que « nos erreurs »… La perfectibilité n’est pas automatiquement le perfectionnement : elle est par exemple responsable chez Rousseau de la corruption sociale de la société dans laquelle il vit.
Progrès et modernité
Le progrès est l’idée phare de la Modernité, au-delà des idéologies politiques particulières. Elle émerge autour des années 1750, et s’avère solidaire d’une certaine conception de l’histoire humaine. Il pouvait y avoir auparavant des progrès, mais « le » progrès voulu pour tel, le changement volontaire et généralisable, sont spécifiques à cette époque. Le progrès devient règle pour l’action. Il prend l’allure d’une puissance de transformation du monde humain en son entier. Avec cette nouvelle perspective du présent, l’humanité découvre « qu’elle est oeuvre à elle-même »[2] (ce qu’elle a toujours été en réalité, mais en l’ignorant et sous une forme larvaire et inconsciente), sa prise de conscience confère son couronnement. Les Lumières vont penser le progrès comme une loi objective inscrite dans les choses, étendue du domaine scientifique et technique au plan moral et social, impliquant un sens bien défini. A la suite de Bacon, des philosophes et savants comme Descartes, Malebranche ou Pascal sont les premiers à sanctifier de façon profane l’importance de la science et l’idée selon laquelle les connaissances s’accumulent au cours du temps. Mais les « Temps nouveaux » qui s’annoncent introduisent plus globalement un rapport au temps totalement remanié et même renversé par rapport à celui de la tradition : il ne s’agit plus de subordonner le présent et l’avenir au passé et à sa valeur fondatrice[3], mais d’une continuité des temps marquée par l’autoproduction consciente et volontaire d’un avenir collectif commun par les acteurs eux-mêmes.Ainsi l’idée de progrès donne naissance aux grandes philosophies de l’histoire, en particulier au matérialisme historique de Marx : pour celui-ci, un processus nécessaire et dialectique (l’histoire est une suite de contradictions surmontées) nous conduit à l’émancipation d’une humanité pleinement réalisée.
Un mythe fondateur
S’il est vrai que le mythe raconte symboliquement le sens profond d’une société ou d’une époque, l’idéologie du progrès constitue à bon droit le mythe fondateur de la Modernité : les hommes, « en se libérant de leurs chaînes » (JJ Rousseau) et de la servitude, en accédant à la connaissance contre l’obscurantisme, en contractant librement entre eux, en donnant libre cours à toutes les énergies productives et créatives en leur sein, vont créer un monde nouveau conforme à leur raison et à leur espérance de bonheur. Cet idéal des Lumières s’applique aussi bien à la production intellectuelle et spirituelle qu’à la production matérielle de biens. La raison est son principal instrument, et ce qu’elle est capable de produire dans le temps ne peut l’être que sous le sceau d’une certaine universalité. Si nous suivons la réflexion de Marcel Gauchet, cette réalisation concrète de l’universel prend en particulier la forme des sciences et des techniques, d’une juridicisation de tous les aspects de la vie sociale, et enfin de l’économie et de la marchandisation (rendue possible par cet « équivalent universel » qu’est la monnaie.
Un scepticisme va se développer par rapport à cet idéal de progrès dès la fin du XIXème siècle. Lisons à ce propos l’interrogation de la Grande Encyclopédie de cette époque (1885-1902), qui anticipe sur la réflexion future des sciences sociales : Quand on parle du progrès que l'histoire nous découvre, ne restreint-on pas « sans y penser l'histoire à notre histoire, ou au moins à celle du monde occidental » ?
2- POURQUOI EST-ELLE MENACEE D’OBSOLESCENCE ?
« Les prémodernes regardent par-dessus leurs épaules un âge d’or inventé mais perdu. Les Modernes regardent devant eux, vers un soleil en souffrance. Nous, post-modernes, nous courons sur un tapis roulant les yeux bandés, après le scoop du jour. » Régis Debray, « Angle mort », 2018
Le développement de la pensée critique
Une pensée critique va interroger l’idée même de progrès : selon Max Weber, il s’y greffe toujours « le concept axiologique d’une époque », c’est-à-dire les critères d’évaluation qu’elle privilégie sans même y penser. Pour utiliser correctement la notion de progrès, il faut le faire dans le sens axiologiquement neutre de progression, dans un domaine bien délimité, comme par exemple celui du progrès technique, avec un point de départ que l’on peut déterminer avec rigueur. L’usage habituel de cette notion serait donc à la fois trop flou et trop subjectif…
L’épistémologue Poppers remet lui en question la croyance en un destin de l’humanité qui serait frappé du sceau de la nécessité, et qui la vouerait à atteindre un but prédéterminé. A travers une telle critique, c’est le déterminisme marxiste qui est prioritairement visé. Certes des tendances peuvent être décrites, susceptibles de varier ou de disparaître selon les conditions, mais la prédiction totale de l’avenir relève de l’irrationnel. Nous retrouvons également chez Hannah Arendt cette critique du déterminisme historique qui enfermerait « le cours objectif des choses » dans des relations de causalité strictes.L’Histoire relève du régime de la possibilité et non de la nécessité, et laisse toute sa place aux actions humaines et à leur irréductible liberté... Et les effets de ces actions ne sont jamais totalement prévisibles... La critique des philosophies de l’histoire nous interdisent aujourd’hui de penser aussi bien l’inéluctabilité des lendemains radieux du communisme, que celle de l’eldorado néolibéral !
Claude Lévi-Strauss, pour sa part, rejoint Max Weber, avec sa critique de l’ethnocentrisme[4] : l’idée erronée d’une partition entre des sociétés à histoire progressive et cumulative, et des sociétés « stationnaires » sont le fruit de l’illusion selon laquelle on perçoit les progrès d’une société à l’aune de ses propres critères de jugement (le développement économique pour les sociétés occidentales). La contestation porte sur un faux évolutionnisme qui prétend placer sur une même échelle de développement l’ensemble des sociétés. Celle-ci correspond en fait aux critères d’évaluation de ceux qui évaluent, en l’occurrence la société occidentale. En réalité les sociétés ne convergent pas vers les mêmes buts, et l’ingéniosité humaine est employée dans des directions différentes ; chaque société privilégie certaines dimensions aux dépens d’autres. D’autre part, le progrès est rarement linéaire, et procède davantage par bonds, tout en s’accompagnant généralement d’un changement d’orientation.
Un relativisme à nuancer
La critique de Levi-Strauss est à bien des égards décisive, mais elle mérite cependant d’être nuancée pour deux raisons : premièrement, la mise en garde est de nature méthodologique et concerne les conditions de validité de toute entreprise ethnologique. Mais cela n’empêche pas nos normes de progrès d’être efficientes dans nos sociétés et d’entraîner la préférence de ses membres pour le modèle culturel qu’elles véhiculent. Deuxièmement, la montée en puissance de la Modernité dans le monde occidental est sans doute un phénomène contingent (nulle nécessité ou destinée), mais elle a était à l’origine d’une mondialisation qui est de fait universelle. Qui aujourd’hui refuse vraiment sa proposition, au-delà des différents régimes de société ? Il ne s’agit pas seulement de domination économique ou du seul attrait des objets de consommation proposés sur le marché. Il faut comprendre qu’avec eux c’est tout l’univers moderne et démocratique qui est associé : ce n’est pas un hasard si la forme « Etat-nation » s’est généralisée dans le monde, avec son incontournable référence à la démocratie (ce qui n’exclut pas qu’elle soit souvent plus « déclarative » qu’effectivement appliquée) ; avec les objets techniques de la modernité, c’est aussi la science, la raison et la culture comme façon de penser que les autres cultures s’approprient à leur manière et sans renier pour autant leurs particularités. En ce sens, l’idée de progrès s’est répandue sur la planète entière, même si celle-ci connaît une crise sans précédent…
Une « crise de l’avenir »
Il ne s’agit plus de questionner l’idée même de progrès comme précédemment, mais de prendre la mesure de la façon dont elle est mise en cause à travers les crises que nos sociétés traversent, et qui apparaissent comme « sans fin »[5]. La source principale de l’anxiété que nous ressentons aujourd’hui face à l’avenir provient du fait que nous sentons bien au fond de nous-mêmes que ce sont nos actions et nos choix qui sont responsables de ce qui nous arrive… Et malgré cela, nous nous sentons impuissants… Ce que nous appelons l’éco-anxiété s’alimente bien sûr sur l’incertitude et le risque, mais plus encore sur le fait que nous sommes pris dans cette boucle négative. Au-delà de cette peur de l’avenir, l’inédit depuis quelques décennies, est que nous avons désormais de la peine à considérer que notre vie sociale a connu un ou des progrès ; certes il y a eu des innovations spectaculaires comme les perfectionnements de l’IA (Chat GPT, la voiture autonome…) ou l’ARN messager, qui vont sans doute bouleverser la vie des gens, mais qui peut prétendre aujourd’hui que cela se traduira par un progrès global et qualitatif pour l’humanité ? Nos imaginaires sont en panne concernant l’avenir[6], et les projections sont brouillées sinon impossibles. Contentons-nous d’évoquer les principaux facteurs qui mettent plus ou moins en échec notre espérance au progrès aujourd’hui :
-
La crise écologique apparaît déterminante de ce point de vue (rappelons ici la crise climatique, les pollutions massives, la pénurie en eau, l’épuisement des ressources, la biodiversité menacée). C’est notre rapport à la nature qui est questionné : le mythe de l’homme prométhéen devient obsolète, et nous savons désormais qu’un véritable développement humain ne peut être compatible avec cette pensée moderne de la Grande séparation entre l’homme (la culture) et la nature[7]. Mais le dualisme du passé – celui d’une action humaine prédatrice sur une nature pensée comme un matériau inerte et illimité – ne doit pas pour autant laisser la place à un nouveau dualisme qui sanctifierait la nature comme norme suprême, aux dépens du monde humain –ce que ne manque pas de faire une écologie dite « profonde ». Les rapports de l’homme avec la nature sont complexes, et il ne suffit pas d’inverser les signes du modèle précédent pour en rendre compte. Le lien nature/progrès doit être réinterrogé, mais cela ne signifie pas que le naturo-centrisme soit la bonne réponse. L’action humaine est nécessairement productrice d’artefacts et de milieux artificiels, toute la question étant de ne pas remettre en cause les équilibres naturels, autrement dit veiller à bien entretenir notre maison. La question centrale d’une telle problématique étant de savoir comment est-il possible de surmonter des contraintes structurelles qui paraissent inhérentes à nos sociétés –notamment la dépendance à toujours plus de croissance – en faveur d’un autre modèle plus « sobre »…
-
Le creusement des inégalités sociales : Malgré les promesses de la Modernité, l’accroissement spectaculaire des richesses (indéniable) a sans doute permis de réduire la pauvreté dans l’absolu, mais n’a pas permis de réduire les écarts : depuis des décennies, écart grandissant entre les riches et les pauvres. La course à la consommation chez certains ne peut plus occulter la pauvreté extrême qui sévit sur les trois quart de la planète. Au sein même des sociétés démocratiques, la sécession du 1% des plus riches par rapport au reste de la population rompt le contrat communautaire[8]. Penser le progrès pour l’humanité sans penser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée produite sur notre planète serait insensé…
-
Une situation géopolitique de plus en plus instable et chaotique. Le rêve de l’après-guerre d’un monde pacifique qui se concrétisait par la création de l’ONU en 1945 semble bien avoir volé en éclats… La nouvelle élection de Trump précipite la mort du multilatéralisme, et les conflits s’enveniment un peu plus…
-
En face de tout cela, l’impuissance du politique sous la puissance d’un système qui donne l’impression de fonctionner tout seul, comme soumis à une dynamique aveugle. Les finalités d’un tel système sont totalement occultées, celui-ci se bornant de façon aveugle à ajuster l’offre à la demande. La bonne marche du complexe juridico-technico-marchand semblant être une finalité en elle-même. Cette impuissance ressentie (et bien réelle !) conduit à la désaffection des citoyens par rapport à la chose publique. Le mouvement de l’histoire semble disparaître derrière le présentisme d’un tel fonctionnement économique automatique. « La marche du capital en vient à prendre le visage du moteur de l’histoire »[9]. Le présentisme se traduit en particulier par des individus se vivant comme déconnectés de la société et de son fonctionnement, principalement mobilisés par leurs intérêts du moment. Quand la puissance ordonnatrice du politique devient évanescente, ce sont les figures même de l’avenir qui disparaissent, et avec elles la croyance au progrès.
Un temps sans promesse
Le temps n’est donc plus le moteur d’une histoire à faire, d’une tâche politique à accomplir, comme il avait pu l’être auparavant. La continuité des temps entre le passé, le présent et l’avenir, semble en quelque sorte rognée par les deux bouts au profit de l’omniprésence du présent, comme si celui-ci absorbait le passé comme le futur. L’avenir apparaît incertain et opaque, quand il n’est pas franchement catastrophique… Le champ d’expérience héritée du passé s’avère incapable de nous informer sur un horizon d’attente. Auparavant, le futur était valorisé comme l’aboutissement d’un progrès. Il n’en est plus ainsi : plus d’avenir téléologiquement orienté vers le mieux, mais un temps sans promesses. L’idée de progrès repose essentiellement sur la possibilité d’un temps vecteur d’amélioration. Il semblerait que ce ne soit plus le cas…
En conclusion, nous pouvons penser que l’idée de progrès a peut-être échappée à son créateur, comme l’illustre le fameux mythe de Frankenstein… Finalement, c’est sans doute dès la grande boucherie de la guerre de 1914, et peut-être plus encore avec la seconde guerre et la Shoah, mais aussi Hiroshima et Nagazaki, qu’une ligne de fracture a commencée de se créer entre les déclinistes et les progressistes désireux de maintenir leur confiance et leur croyance au progrès. Une chose est sûre : nous sommes orphelins d’une philosophie de l’histoire et des grands récits qui l’accompagnent. Le mythe du progrès, au point de départ de l’avènement de la Modernité, ne peut y survivre, aussi bien dans sa version libérale que dans sa version révolutionnaire… Mais cela signifie-t-il qu’il n’est plus possible de se construire un horizon ?
3- PEUT-ON SE PASSER D’UN AVENIR PROMETTEUR ?
« Nous les occidentaux, il nous est indispensable de nous situer dans la perspective d’un temps prometteur », Emmanuel Lévinas
Le paradoxe de la situation
Emmanuel Lévinas pensait que les êtres humains du monde occidental étaient disposés à penser depuis la Bible que le monde allait quelque part, et promettait quelque chose ; malgré les vicissitudes rencontrées. Cette pensée vaut au moins pour l’univers moderne, comme nous venons de le voir. Nous nous trouvons devant un paradoxe : c’est au moment où la radicalisation de la Modernité depuis les années 70 nous rend potentiellement complètement autonomes que nous perdons le fil de l’avenir… Que faire de cette liberté nouvelle si elle ne peut pas se traduire en pouvoir de tous ? Nous sommes censés enfin pouvoir décider qui nous sommes et ce que nous voulons devenir, or l’avenir se dérobe sous nos pieds, et le progrès ne constitue plus une valeur incontestée. Comment faire pour exercer vraiment cette liberté ? Frappés par l’incertitude du devenir, les modernes ne parviennent plus à se fixer des buts dans le cadre d’un temps qui serait, comme auparavant, un vecteur d’amélioration.La croyance au progrès serait-elle devenue obsolète ?
Crise dans la modernité ou crise de la modernité ?
La question posée pourrait se formuler ainsi : la crise que nous vivons est-elle susceptible d’un dépassement dans le cadre de la Modernité elle-même ? Dans ce cas nous pourrions parler d’une crise dans la Modernité… Moments de troubles, voire de convulsions futures, mais susceptibles d’un dépassement possible. Ou bien s’agit-il d’un épuisement définitif du modèle de la modernité, d’une rupture radicale, sanctionnant un seuil d’époque ? Corrélatif d’une forme de dislocation des temps, révélatrice d’une crise de la Modernité ? Au fond, peut-on vivre sans un sens de l’histoire ?[10] Envisageons rapidement quelques options possibles face à la crise :
Nous sommes en train de sortir de la Modernité ?
Nous franchissons ainsi un seuil d’époque pour entrer dans « la postmodernité »[11], en s’écartant du schéma directeur de la Modernité. Il est difficile de dire quelque chose d’une postmodernité qui serait en train d’advenir. Si l’on en croit Michel Mafesoli, cette nouvelle époque serait marquée par le retour de formes archaïques de vivre ensemble (retour des communautés), qui rompraient avec l’économicisme ambiant. Nous renouerions avec une forme cyclique du temps (a-t-elle jamais existée ?), et l’idée moderne de progrès deviendrait totalement obsolète, et avec elle les valeurs du contrat social ou de la démocratie…
Toujours plus de la même chose ?
A l’inverse de cette thèse, beaucoup pensent, dans une perspective continuiste des temps présents, que nous continuerons dans la même dynamique économique et sociale : dans cette hypothèse, la projection mécanique de « toujours plus de la même chose », c’est-à-dire toujours plus d’innovations, de productions, de consommations, conduirait inexorablement vers un horizon de désastre plutôt que de progrès ! C’est dans cette vision que se reconnaissent divers courants de pensée autour de l’effondrement et de la collapsologie. Certains même, dans la perspective d’une fin de ce monde désormais inévitable, préconise une forme d’hédonisme nihiliste centré sur une jouissance personnelle sans frein… Après moi, le déluge.
Le « solutionnisme » technologique ?
Dans la même veine, il y a ceux qui prônent le « solutionnisme » technologique ; dans les deux cas, l’adaptation est le maître mot : nous n’avons d’autres choix que d’accompagner au mieux possible cette dynamique aveugle et automatique et de nous adapter. L’IA et le transhumanisme doivent venir à la rescousse, la puissance technologique devant en quelque sorte pallier à l’impuissance politique.
La voie d’une autonomie véritable
Revenons à notre paradoxe : comment exercer notre liberté ? Nous savons en effet aujourd’hui, contrairement à ce que les philosophies de l’histoire donnaient à penser, qu’aucune nécessité interne ou déterminisme nous prédestine à en faire bon usage. Dans ce moment de « suspend historique », nous sommes au croisement de deux chemins : libres de nous accommoder ou non au monde tel qu’il est ; de nous rendre davantage maîtres – ou non – du fonctionnement de notre démocratie et de l’orientation de notre avenir. C’est dans ce mouvement que l’on peut comprendre l’apport de la philosophie. Pourrons-nous surmonter l’impuissance du politique dans le sens de sa réactivation, dans le sens moderne d’un véritable autogouvernement de soi sur soi ? L’idée de progrès chère à la Modernité peut-elle être préservée dans le cadre d’une nouvelle pensée de l’Histoire ? Elle ne peut plus comme avant être inscrite dans un temps téléologiquement orienté et marqué du sceau de la nécessité. Rien n’est joué d’avance, nous sommes désormais voué à construire notre avenir dans un monde parfaitement incertain. Poursuivre aujourd’hui l’œuvre moderne, c’est exercer cette pensée critique tout en reconduisant l’idée de progrès comme idéal. Cette nouvelle configuration possible devrait être capable d’intégrer une partie des réponses présentes dans les autres options. Elle ne pourra pas faire l’impasse des mises en garde de Hans Jonas sur la façon dont l’homme met en péril sa propre demeure ; le « catastrophisme éclairé » est peut-être de nature à nous faire éviter le pire, le progrès étant alors indissociable du danger à anticiper et éviter[12]… Et par conséquent également d’une certaine modération ou sobriété. Mais elle devra également miser sur les nouvelles technologies, qu’il s’agisse de l’IA, mais aussi de nouvelles techniques d’écologie industrielle et circulaire, mais aussi des sciences du vivant et de la biotechnologie qui offrent des possibilités concernant les grands besoins mondiaux relatifs à la santé, au vieillissement, à l’alimentation, à l’environnement[13]. *
Il ne s’agit pasde rompre radicalement avec le projet de la Modernité, mais d’exercer de nouveau notre pensée pour nous sauver des travers de ce qu’elle a produit jusqu’à présent. Retrouver la capacité la plus étendue et la plus éclairée possible de décider en commun et d’agir collectivement sur soi. Et par conséquent nous devons réorienter le progrès autrement en tirant toutes les conséquences des limites d’une artificialisation sans mesure du monde humain qui nous conduit à un découplage total entre le technocosme humain et la nature, et engendrerait « un monde politiquement intenable, personnellement invivable, et écologiquement insoutenable »[14]. Peut-être qu’aujourd’hui le progrès global (et non seulement les progrès particuliers dans tel ou tel domaine) se mesure davantage en termes de réparation du monde qu’en termes de transformation[15]. Mais cela ne sera possible qu’à partir d’une prise de conscience des limites de l’individu privé de droit et de ses intérêts, au profit d’une nouvelle manière de vivre notre être en société.
Pour conclure tout à fait,
il nous apparaît inconcevable, dans une démocratie où les individus sont censés avoir la responsabilité de leur sort et de leur avenir, de ne pas reconduire l’idée de progrès : comment agir individuellement et collectivement en l’absence d’une confiance raisonnable en l’avenir ? La remise en question de l’idée dogmatique d’un progrès qui serait continu et inéluctable, ne doit pas nous empêcher de conserver toute sa valeur au progrès, au sens où nous avons besoin de penser l’avenir comme source de mieux. Le rôle du politique est précisément de définir une bannière commune et ainsi rallumer l’espérance (ce qu’il ne parvient plus à faire).
[1]La question se pose aussitôt de savoir : mieux par rapport à quel critère ?
[2] Marcel Gauchet
[3] Dans les sociétés traditionnelles, c’est le passé qui est source de sens, et le « nouveau » un péché capital. .L’héritage est reproduction et imitation
[4] « Race et Histoire »
[5] « La crise sans fin », Myriam Revault d’Allonnes
[6] Depuis la fin des « grands récits » annoncée par François Lyotard.
[7] Philippe Descola « Au-delà de nature et culture »
[8]« La société des égaux », Pierre Rosanvallon
[9] Marcel Gauchet, « Le nœud démocratique »
[10] C’est une des questions posées par Myriam Revault d’Allonnes dans son livre « Une crise sans fin »
[11] Un auteur comme Michel Maffesoli défend cette thèse
[12] C’est la thèse défendue par Jean Pierre Dupuy
[13] Pierre-Benoît Joly, Benjamin Raimbault, « Biologie de synthèse et sciences sociales, un dialogue difficile », « Pour la science », 2014 .
[14] Marcel Gauchet
[15] Je crois que c’est ce que disait déjà Camus lors de son discours de Stockholm (Prix Nobel de littérature)